Chapitre Littéraire
Naviguer dans le tissu complexe de la vie, les choix dévoilent des chemins vers l’extraordinaire, exigeant créativité, curiosité et courage pour un voyage vraiment épanouissant.
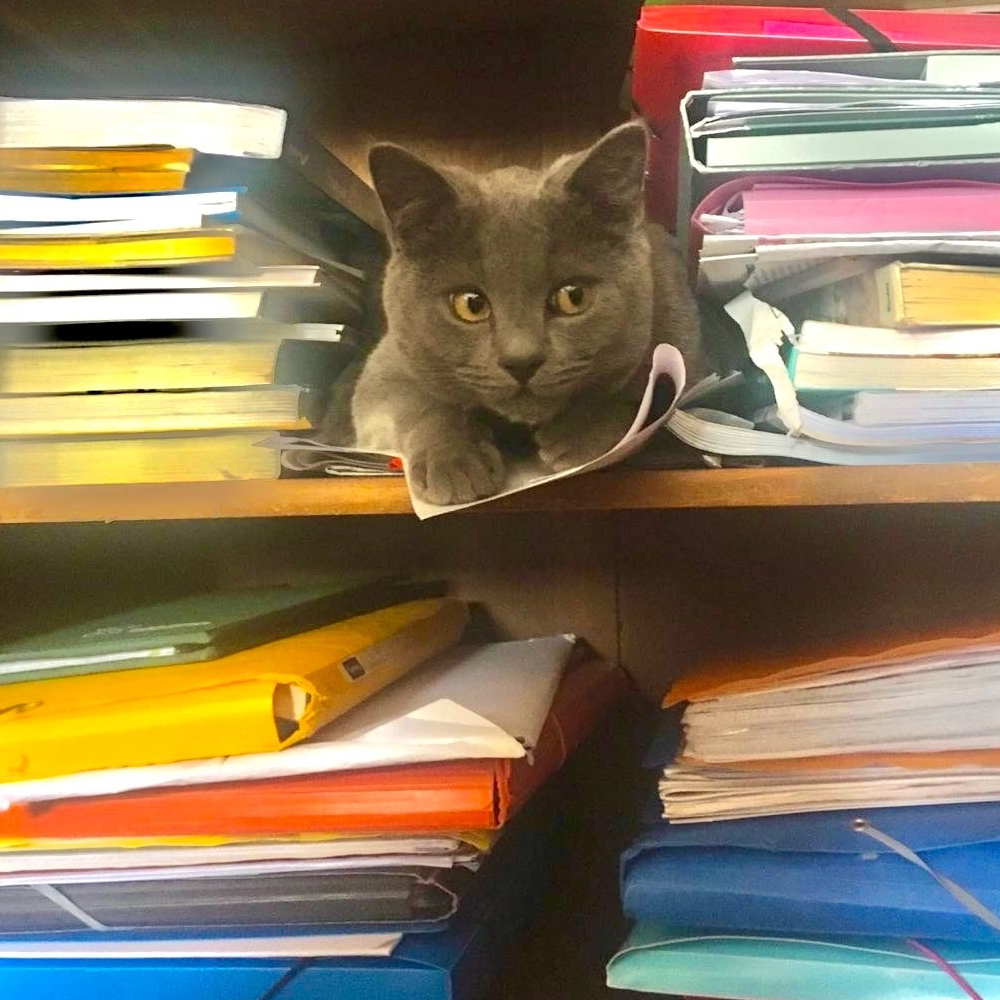

La mort du philosophe à travers Phédon
Platon écrit dans ce dialogue les adieux de Socrate, qui a été condamné à boire la ciguë. Le philosophe explique quelle doit être l’attitude du philosophe devant la mort.
La thèse centrale que défend ici Socrate devant Simmias et Cébès est que le philosophe recherche et pratique la mort. En effet, la quête du philosophe consiste en la recherche de la vérité et de la sagesse. Celle-ci ne peut être accomplie que par l’âme qu’il faut donc séparer du corps car ce dernier est un obstacle, un mal qui peut la tromper et l’empêcher d’accéder à la vérité. Socrate définit la mort comme « la séparation de l’âme d’avec le corps », elle est donc l’état que le philosophe poursuit toute sa vie. Il s’y adonne même puisqu’il écarte autant que possible son corps de son âme. Ainsi, le philosophe est coutumier de la mort et n’a donc pas de raison de la fuir et de se rebeller quand celle-ci viendra.
Dans le processus de la connaissance, la pensée doit se débarrasser du corps. En effet, les sens peuvent être trompeurs (notamment la vue et l’ouïe qui sont les sens supérieurs). Ensuite, selon Socrate, la douleur, les sentiments et les plaisirs induisent également en erreur. Le corps est aussi source de difficultés car il est nécessaire de le nourrir et il est vulnérable aux maladies. Il faut donc se débarrasser du corps car il détourne l’âme de sa quête du savoir et de la vérité : les souffrances et les besoins éloignent la pensée du processus de connaissance.
Socrate différencie le désir des hommes et celui du philosophe.Pour le commun des mortels, le sel de la vie réside dans les plaisirs et les « jouissances corporelles ». Selon Socrate, celles-ci sont par exemple manger, boire, l’amour, ou encore les soins du corps comme « la beauté des habits et des chaussures » ou autres ornements. Alors que la quête du philosophe est de connaître l’essence des choses, leur réalité. En effet, l’âme désire atteindre la vérité pure. Socrate affirme « que l’objet de nos désirs, c’est la vérité » et de la « connaître purement ».
Pour Socrate, l’âme se rapporte à la sagesse, la pureté, la raison, la tempérance et la bravoure. Le corps est quant à lui assimilé au mal, à l’esclavage, à l’impureté, à la confusion et aux sentiments vains de la vie terrestre (amours, désirs, craintes, honneurs, peur, lâcheté). Il est la cause de guerres, dissensions et batailles. Le corps paralyse et souille l’âme par son intempérance. Socrate le compare longuement à une prison.
Socrate affirme que c’est « par peur et par crainte que les hommes sont courageux ». Cette formule est étonnante car c’est un paradoxe. En effet, ces émotions sont opposées : la peur et la crainte sont synonymes mais forment une antithèse avec le courage. Socrate affirme que la cause du courage est la peur, ce qui est étonnant au premier abord. Cette affirmation signifie que les actes de courage de tous les hommes, exceptés les philosophes, ne sont pas dictés par leur courage. Ils craignent un mal plus grand que celui qu’ils combattent avec courage. La cause première n’est donc pas le courage mais « la crainte de maux plus grands », dont ils sont esclaves.
Seuls les philosophes font acte de courage pur, puisqu’ils supportent la mort sans nulle crainte.
L’argument de Socrate laisse Cébès dubitatif sur un point : la permanence de l’âme après la mort. Cébès demande à Socrate une démonstration de la persistance de l’âme sans le corps. Pour lui, sans un examen approfondi de la question, l’âme se disperse et devient néant.
Selon Socrate, vivre c’est revivre. En effet, il s’en tient a une ancienne tradition qui montre que rien ne disparaît et que les vivants naissent des morts. La naissance et la mort sont deux états où l’âme passe de l’un à l’autre. L’âme serait dans l’Hadès et « renaîtrait » dans un corps car une chose nait de son contraire. On peut donc parler de vie dans la mort et renaissance dans la vie. Socrate évoque une « génération » car un état en génère un autre.
La réminiscence, c’est l’idée que l’âme sait tout mais que lorsqu’elle naît dans un corps, elle oublie toutes ses connaissances déjà acquises. Tout ce que l’homme apprendra dans sa vie ne sera donc qu’un rappel : il se ressouvient. Réminiscence et immortalité de l’âme sont donc indissociables.
Socrate fait donc un raisonnement par opposition : il expose le raisonnement du « vulgaire » en montrant que c’est une erreur. Puis il explique à Cébès comment raisonne véritablement l’âme du philosophe. Celle-ci se détourne toute sa vie des plaisirs et des peines et se préoccupe non pas de l’opinion mais de la pensée divine car c’est là ou résident la sagesse et la raison pure. Après la mort, le philosophe se retrouve dans un état de détachement similaire à celui qu’il a pratiqué toute sa vie. Il y a donc une parenté entre sa vie et son état dans l’Hadès.

Notre sentiment de liberté nous trompe… Le libre-arbitre selon Nietzsche
« Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges » affirme Nietzsche dans Humain, trop humain. Cet aphorisme révèle qu’il ne faut pas se fier aux certitudes. Le philosophe allemand expose une vision de la liberté fondée sur le sentiment que nous en avons puis la réfute et donne sa conception du libre arbitre.
Dans un premier temps, Nietzsche expose l’idée selon laquelle l’homme se sent indépendant donc s’estime libre. En effet, l’homme se juge indépendant tant qu’il ne se sent pas dépendant. Il se croit donc libre puisque ses actes ne semblent pas déterminés par des causes extérieures à sa propre volonté. Cette pensée est pour Nietzsche un « sophisme », un raisonnement qui porte en lui l’apparence de la rigueur et de l’évidence, mais qui n’est en réalité pas valide. L’homme s’estime libre comme ne dépendant de rien d’autre que de sa propre volonté. Cela va à l’encontre de la théorie du déterminisme, notamment démontrée par Spinosa, qui affirme que tous les phénomènes naturels et les faits humains sont causés par des antécédents. L’homme n’ayant pas conscience d’un grand nombre de ces causes extérieures pense qu’elles n’existent pas : c’est une fausse évidence qui le mène à croire qu’il est libre. Nietzsche emploi les adjectifs « orgueilleux » et « despotique » pour qualifier l’homme car tout obéit à des liens de causalité et qu’il n’est pas une exception dans la nature. Plus encore, la cause de cet orgueil et de ce despotisme réside dans le fait que l’homme affirme qu’il s’apercevrait à coup sûr qu’il est dépendant. Il est persuadé qu’il saurait reconnaître les contraintes qui s’opposent à sa volonté. Comme il ne ressent aucune dépendance, il est selon lui libre car s’il était soumis à des contraintes il s’en rendrait compte. Son postulat est qu’il vit selon sa propre volonté d’agir et qu’il est libre de ses actes et de ses choix. Cette hypothèse. qui ne peut être démontré, mais qu’on doit tout de même admettre pour définir la liberté de l’homme, fait écho à la pensée de Descartes dans Principes (I, 39) où il affirme qu’« il est si évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus communes notions ». Selon Nietzsche, l’homme ne reconnaît sa dépendance que lorsqu’il perd l’indépendance dans laquelle il vit par habitude. Cette notion d’habitude est centrale pour Nietzsche et s’oppose à l’exception. Comme l’habitude de l’homme est de se sentir indépendant, ce n’est que quand il ressent des contraintes à sa liberté qu’il n’est exceptionnellement pas libre : son habitude est bouleversée.
Dans un second temps, l’auteur pose le postulat inverse et redéfinit le libre arbitre. Il fait l’hypothèse que le premier postulat est faux et ne correspond pas à la réalité. L’homme vivrait constamment dans la dépendance et ne se sentirait libre que quand il s’habitue à ses chaînes. Cette liberté n’est donc pas totale car l’homme est fondamentalement dépendant et de diverses manières. En effet, il y a plusieurs formes de dépendance. Même si Nietzsche ne les cite pas, on peut penser au déterminisme génétique, social ou encore de la nature : tout ce qui obéit à des lois de causalité dont l’homme ne voit pas toute la portée. Cette liberté est relative au degré d’accoutumance de l’homme aux contraintes, à ses chaînes. Il faut que celles-ci fassent partie de l’homme pour qu’il ne les perçoive plus et qu’elles ne soient donc plus des entraves à sa liberté. Elles doivent devenir de l’ordre de l’usage inconscient. Enfin, si l’on accepte ce postulat, le libre arbitre ne signifie plus une volonté totalement libre mais une illusion. Le philosophe ne nie pas que l’on puisse encore souffrir. En effet, l’homme qui n’est pas accoutumé à toutes ses chaînes peut souffrir de celles qu’il n’a pas intériorisées. L’homme ne souffre
donc plus d’une perte de liberté mais d’une inadaptation à ses chaînes. Il se rend compte de ses chaînes et pense qu’elles sont « nouvelles » alors qu’il n’est simplement pas habitué à elles. Nietzsche donne donc une nouvelle définition du libre arbitre qui n’est autre que savoir s’accoutumer à toutes ses chaînes. C’est transformer le sentiment de contrainte en une habitude qui finira par être inconsciente et dont l’homme ne se préoccupera plus car elle sera de l’ordre de l’évidence.
En conclusion, le sentiment de liberté de l’homme n’est pas fiable. Le postulat de l’homme est qu’il est indépendant et qu’il possède un libre arbitre qui est la volonté libre de faire un choix. Nietzsche pose l’hypothèse d’un postulat inverse pour contrer cette fausse évidence, ce qui change drastiquement la signification du libre arbitre. Ce n’est plus le pouvoir absolu de décision mais une assimilation des chaînes, des contraintes. L’homme a l’impression qu’il prend une décision libre mais il ne prend que la décision de s’accoutumer à ses chaînes selon le philosophe. Celui-ci nous montre donc que « la liberté c’est de savoir danser avec ses chaînes ». Il affirme que l’homme est dépendant mais qu’il peut tout de même trouver une part de liberté lorsqu’il s’accommode de ses limites dont il n’aura alors plus conscience.

Une leçon avec Ionesco
La Leçon, écrite en 1950, est l’une des premières oeuvres d’Eugène Ionesco. Elle mêle la farce à la tragédie. C’est un « drame comique » qui s’éloigne du théâtre traditionnel : la pièce se résume à un seul acte, sans découpage en scènes et son dénouement indique un recommencement en boucle. Les trois personnages représentent trois fonctions typiques c’est-à-dire la bonne, la jeune élève et le professeur.
Ionesco refuse la dénomination de « théâtre de l’absurde », même si les phrases, les raisonnements et les réactions des personnages sont absurdes, pour lui préférer celle de « théâtre de l’insolite ».
Ionesco écrit dans ses Notes et contre-notes que « le spectacle de guignol [le] tenait là, comme stupéfait, par la vision de ces poupées qui parlaient, qui bougeaient, se matraquaient. C’était le spectacle même du monde, qui, insolite, invraisemblable, mais plus vrai que le vrai, se présentait à [lui] sous une forme infiniment simplifiée et caricaturale, comme pour en souligner la grotesque et brutale vérité. »
La pièce débute avec l’arrivée d’une élève de 18 ans dans l’appartement d’un professeur particulier. Après avoir été accueillie par Marie, la bonne, elle patiente assise à la table du salon. Le professeur d’une cinquantaine d’années la rejoint au bout de quelques minutes et le cours commence. L’étudiante veut passer son « doctorat total » et demande donc au professeur de la faire étudier.
L’enseignant aborde tout d’abord la géographie et les saisons puis travaille l’arithmétique. L’élève n’arrive pas à résoudre des raisonnements simples comme des additions ou des soustractions mais arrive à répondre à des multiplications très complexes. Elle lui explique donc qu’elle a appris tout les résultats par cœur.
Le professeur poursuit le cours avec une leçon de linguistique et de philologie. Il est interrompu par Marie qui lui recommande de s’arrêter. L’homme n’écoute pas et entame un cours ridicule sur les langues « néo-espagnoles ».
La tension monte tandis que l’élève devient passive et épuisée. Seules les quelques protestations de la jeune fille, « j’ai mal aux dents », ponctuent le monologue absurde et grotesque du professeur. Le professeur ne semble plus se contrôler : devant l’absence de participation de l’élève, il bascule dans la folie et la brutalité. Pour illustrer son cours de langue, il s’empare d’un couteau qu’il agite devant la jeune fille en répétant de façon insensée « couteau ». Enragé, il poignarde l’élève et tombe soulagé, fatigué.
La bonne constate le décès et gronde le vieillard paniqué, tel un enfant: « Et je vous avais bien averti, pourtant, tout à l’heure encore : l’arithmétique mène à la philologie, et la philologie mène au crime… ». C’est en effet le 40ème meurtre que commet le professeur ce jour-là. Elle lui propose néanmoins son aide pour les funérailles. Mais voilà qu’on sonne à la porte. La bonne ouvre et une nouvelle élève se présente.
Cette pièce illustre bien le rapport entre rire et savoir. D’une part, il y est question de la transmission d’un savoir grotesque. D’autre part, c’est l’enseignement que Ionesco transmet au spectateur par le rire et qu’il tire de son expérience avec les régimes totalitaires : la volonté de pouvoir est illimitée, il soumet les plus faibles jusqu’à la mort et chacun arrive à collaborer avec le fascisme malgré son opposition initiale.
J’ai beaucoup aimé cette courte pièce de théâtre. La lecture était agréable et facile. Je pouvais bien me représenter la scène grâce aux nombreuses didascalies. La chute et le fait que la pièce soit une boucle continuelle m’a beaucoup plu. En effet, à la fin du texte, certaines didascalies nous font comprendre que les coups de marteau pour fermer le cercueil de la nouvelle victime étaient présents au début de la représentation. Mais également que durant la représentation, lors de son entrée en scène, la bonne jette les affaires de l’élève dans un coin de la pièce sur un tas d’autres cartables et cahiers. Le retard du professeur au début du cours est donc enfin compris par le spectateur ou le lecteur qui réalise que celui-ci était en train de s’occuper du corps de sa victime précédente.
Il faut voir cette pièce au théâtre de la Huchette pour me rendre compte de sa mise en scène. Ionesco avait donné son accord au metteur en scène de La Leçon, Marcel Cuvelier, en 1951, pour des modifications. Par exemple, pouvoir supprimer le brassard que devait porter le professeur à la fin de la pièce. Ionesco avait indiqué « brassard avec une croix gammée ». La dictature, Cuvelier préfère en effet « l’évoquer que la montrer ». J’apprécie ce deuxième degré de compréhension de la pièce.
LE PROFESSEUR, de plus en plus étonné, calcule mentalement.
Oui… Vous avez raison… le produit est bien… (il bredouille inintelligiblement). … quintillions, quadrillions, trillions, milliards, millions… (Distinctement.) … cent soixante-quatre mille cinq cent huit… (Stupéfait.) Mais comment le savez-vous, si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement arithmétique ?
L’ÉLÈVE.
C’est simple. Ne pouvant me fier à mon raisonnement, j’ai appris par coeur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles.
LE PROFESSEUR.
C’est assez fort… Pourtant, vous me permettrez de vous avouer que cela ne me satisfait pas, Mademoiselle, et je ne vous féliciterai pas : en mathématiques et en arithmétique tout spécialement, ce qui compte – car en arithmétique il faut toujours compter – ce qui compte, c’est surtout de comprendre…
Cet extrait se situe durant le cours d’arithmétique. Le professeur essaye d’enseigner les bases de la soustraction à la jeune élève : elle n’arrive pas à soustraire de très simples calculs (quatre moins un). Premier effet comique étant donné qu’elle a 18 ans et son bac.
L’enseignant, excédé, lui explique que si elle ne parvient pas à « comprendre profondément ces principes », elle n’atteindra jamais le poste de polytechnicien. Que le professeur lui fasse réviser les soustractions est un autre effet du comique car le rapport de cause à effet entre la compréhension d’un principe aussi élémentaire que celui-ci et une formation aussi difficile que polytechnicien est absurde. Pourtant, maître et élève semblent s’accorder, pour l’instant, sur cette idée.
Pour lui prouver qu’elle n’arrivera pas à résoudre les problèmes auxquels un ingénieur moyen devrait avoir la solution, il lui pose un produit très complexe. L’élève répond très rapidement « dix-neuf quintillions trois cent quatre-vingt-dix quadrillions deux trillions huit cent quarante-quatre milliards deux cent dix-neuf millions cent soixante-quatre mille cinq cent huit ». Le professeur tombe des nues mais le lecteur aussi : il y a un décalage entre ce à quoi s’attendait le lecteur et ce qu’il se passe.
L’enseignant recalcule et se rend compte, après voir vérifié,qu’elle a raison. Il lui demande alors comment cela est possible et elle explique qu’elle a appris tout les résultats de toutes les multiplications possibles par cœur.
Selon Ionesco puisqu’il faut « donner au théâtre sa vraie mesure, qui est dans la démesure », l’impossibilité de calculer ce résultat, de retenir toutes les infinités de possibilités et d’une telle simplicité est vraiment insolite.
On peut voir un certain rapprochement entre ce passage et le livre Gargantua de Rabelais. En effet, celui-ci dénonce l’enseignement scolastique traditionnel qui revient à l’apprentissage d’un savoir livresque. Dans La Leçon, l’étudiante a appris de mémoire les résultats de ses calculs et ne sais pas les résoudre grâce à l’arithmétique. Mais également avec Le Bourgeois Gentilhomme de Molière puisque le professeur de philosophie accepte de lui apprendre comment positionner sa bouche pour faire les bons sons des voyelles.